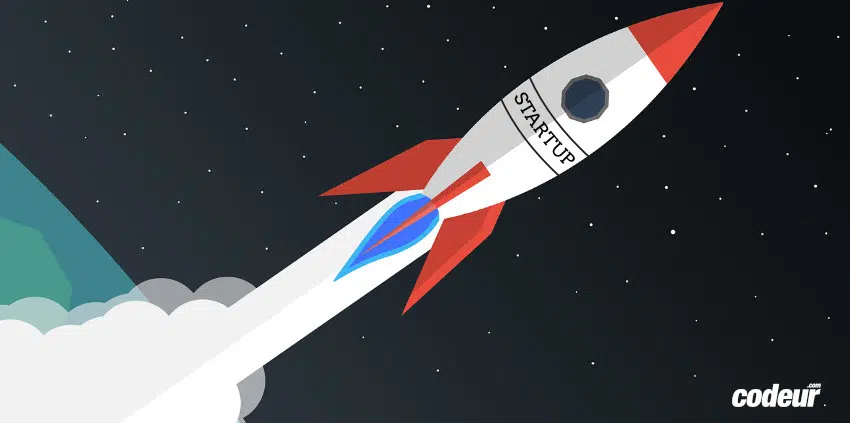Un chiffre, pas une histoire : 4,35 euros. C’est la somme minimale, à l’heure, que doit toucher un stagiaire en 2025 pour tout stage dépassant deux mois. Pourtant, derrière cette règle en apparence limpide, les disparités foisonnent. Certaines entreprises couvrent généreusement les jours fériés, d’autres les ignorent sans sourciller. Résultat : pour une même période, deux étudiants peuvent voir leur gratification fondre ou gonfler selon l’adresse de leur employeur.
La loi ne s’aventure guère sur le terrain des ponts ou des fermetures exceptionnelles. Cette absence d’encadrement laisse chaque structure interpréter à sa façon, multipliant les adaptations administratives et budgétaires. Employeurs comme stagiaires doivent composer avec ce paysage mouvant, où l’incertitude s’invite chaque année dans la gestion des conventions.
Ce que dit la loi sur la gratification des stagiaires en 2025
La gratification de stage s’impose dès lors que la durée atteint deux mois, peu importe que ces mois soient consécutifs ou non, pourvu que cela s’inscrive dans la même structure sur une année universitaire. En 2025, le montant minimal légal s’aligne toujours sur le plafond horaire de la sécurité sociale. Concrètement, cela se traduit par 4,35 euros par heure de présence, soit près de 660 euros mensuels sur la base d’un temps plein. Une somme qui ne fluctue ni en fonction du niveau d’études, ni selon la filière, ni selon la taille de l’organisation d’accueil.
Le calcul de la gratification repose uniquement sur les heures de présence réelle. Les absences sans justificatif, les congés extérieurs à la convention et les jours fériés non travaillés passent à la trappe dans le calcul. Pourtant, rien n’interdit à une entreprise d’aller au-delà et d’intégrer ces journées si elle le souhaite.
Pour y voir clair, voici ce qui compte particulièrement en matière de rémunération sur le bulletin de stage :
- Exonération des cotisations sociales : tant que la gratification reste pile sur le seuil légal, aucune charge sociale ne vient grever la somme versée. La partie qui dépasse reste, elle, soumise à cotisations sociales.
- SMIC et stage : ce régime fixe n’a pas la moindre influence sur le statut ou le traitement en paie, qui diffèrent nettement du salaire minimum habituel.
Le texte légal encadre le statut du stagiaire, tout en ménageant une vraie marge de manœuvre aux entreprises pour adapter la rémunération. La convention de stage précise la durée, le montant, les éventuels avantages (remboursement transport, titres restaurant…), balisant les relations entre l’établissement d’enseignement, l’entreprise et l’étudiant.
Jours fériés et absences : quels impacts concrets sur la rémunération ?
Les jours fériés et les absences ont une incidence directe sur la rémunération des stagiaires. Seules les heures où le jeune est réellement présent comptent pour calculer la gratification. Lorsqu’un jour férié n’est pas travaillé, aucune compensation n’est attendue, sauf mention expresse dans la convention de stage.
Ce principe, loin d’être connu de tous, aboutit à des pratiques contrastées. Certains employeurs appliquent une stricte égalité avec les salariés et maintiennent la gratification sur les jours fériés chômés ; d’autres, plus littéraux, retranchent chaque journée non travaillée du montant dû. La rédaction de la convention fixe ce cadre, évitant malentendus et déceptions de dernière minute.
En général, voici les situations fréquemment rencontrées lorsqu’il s’agit de traiter les absences et leur impact sur le versement :
- Les absences autorisées, arrêt maladie, rendez-vous médicaux, événements familiaux précisés dans la convention, ne sont habituellement pas prises en compte pour la gratification, sauf décision contraire de l’employeur.
- Les congés non prévus par la convention, tout comme les retards répétés ou absences injustifiées, entraînent chaque fois une baisse du montant à percevoir.
Les avantages annexes comme le remboursement du transport ou les tickets restaurant ne servent pas de rattrapage en cas de baisse de gratification par suite d’absences. Pour l’étudiant, poser d’emblée un cadre clair évite la confusion et garantit une relation plus prévisible avec l’entreprise. Cette transparence, sur les absences comme sur les règles de présence, nourrit aussi le sentiment d’appartenance et de valorisation, bien au-delà de la somme affichée sur le compte en banque.
Variations saisonnières : pourquoi le coût d’un stagiaire peut changer selon la période de l’année
Le montant touché par le stagiaire n’est jamais totalement figé : le calendrier entre en jeu. Selon la saison, la facture peut grimper ou diminuer pour l’employeur. Au printemps, la palanquée de jours fériés réduit mécaniquement le nombre d’heures travaillées ; à l’automne, tout s’aligne, avec moins d’interruptions. Le total mensuel, lui, s’ajuste au nombre réel d’heures effectuées.
Dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, le pic de la demande intervient au printemps. L’agenda universitaire finit par peser sur le marché : juin et juillet voient une ruée vers les meilleurs profils, ce qui peut faire monter la gratification proposée. À l’inverse, les mois plus calmes, décembre, février, ouvrent la porte à plus de souplesse côté employeur pour négocier.
Regardons de plus près comment saison et lieu influent concrètement sur la gestion des missions et le quotidien du stagiaire :
- Dans les secteurs marqués par la saisonnalité (tourisme, événementiel), la forte affluence de stagiaires se concentre sur quelques mois phares. C’est plus coûteux pour l’entreprise mais aussi souvent plus formateur pour l’étudiant.
- Les fluctuations d’activité dans des métropoles comme Marseille, Bordeaux, Lille impactent la répartition des dossiers et le niveau d’encadrement que le stagiaire peut recevoir.
Les entreprises n’attendent plus le hasard pour construire leur politique de stages : elles intègrent désormais ces variables dans leur réflexion RH. Offrir de vraies responsabilités et valoriser la progression du stagiaire, voilà ce qui fidélise désormais autant que le montant affiché.
Des solutions pour anticiper et optimiser la gestion des stages face aux évolutions législatives
L’évolution du cadre légal pour 2025 pousse entreprises et écoles à réinventer leur façon d’accueillir. Déployer des parcours d’intégration mieux structurés facilite la prise de poste et garantit le respect des nouvelles exigences. Les responsables RH misent sur des outils éprouvés : suivi individualisé, conventions ajustées, veille constante sur les ajustements de la loi.
En organisant efficacement la gestion des absences anticipées et en incluant les jours fériés dans les calculs, employeurs et stagiaires se prémunissent contre les frustrations. Certaines aides publiques, généralement peu exploitées, peuvent aussi venir alléger le budget tout en accompagnant la montée en compétence des jeunes.
Pour transformer l’accueil et renforcer l’engagement autour du stage, plusieurs leviers peuvent être renforcés :
- Dynamiser la communication interne pour booster la cohésion et assurer la transmission de savoirs.
- Mobiliser les dispositifs de VAE (validation des acquis de l’expérience) et de CPF afin de bâtir un parcours progressif autour du stage.
- Prévoir les dépenses connexes : repas, déplacements, hébergement, en s’alignant sur ce que détaille la convention de stage.
Garder une organisation affûtée et entretenir le dialogue régulier avec les équipes RH : voilà deux atouts décisifs pour traverser les zones de turbulence réglementaire sans perdre la main sur la qualité de l’accueil et l’expérience vécue par les stagiaires. Le contrat n’est plus un simple papier : c’est le point d’équilibre pour conjuguer flexibilité, conformité et reconnaissance, saison après saison.