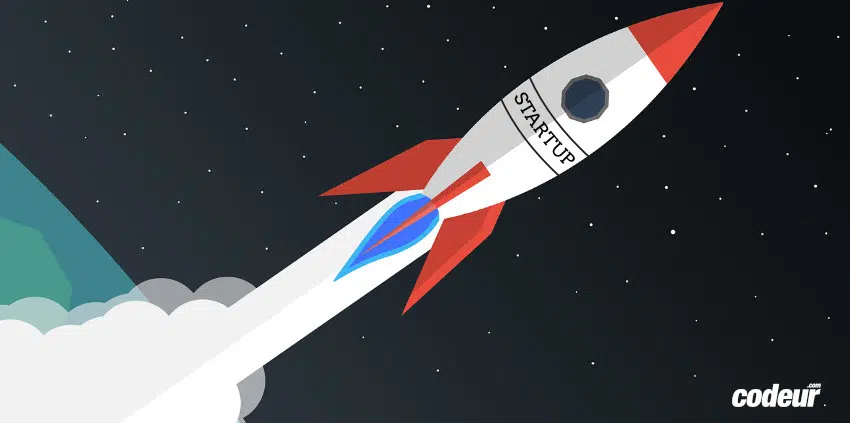Dérogation, suspension, portabilité : trois mots qui, dans le paysage de la formation professionnelle française, ne relèvent pas du jargon mais bien d’une réalité vécue par chaque salarié. Un employé a la possibilité, sous réserve de remplir certains critères, de s’absenter de son poste pour se former et continuer de percevoir une partie de son salaire. Avant 2014, le Droit Individuel à la Formation (DIF) ouvrait droit à des heures cumulées, utilisables même après un changement d’employeur. Depuis, le Compte Personnel de Formation (CPF) a pris le relais, redéfinissant les contours de cette « portabilité » tant attendue.
Selon la taille ou le secteur d’activité, certaines entreprises se voient imposer le financement de la formation continue, alors que d’autres s’en remettent au volontariat. La loi oblige également à organiser régulièrement des entretiens professionnels, leur absence expose l’employeur à des sanctions. Les textes évoluent fréquemment et redistribuent sans cesse les cartes des droits et des responsabilités.
Panorama des lois encadrant la formation professionnelle en France
Le socle réglementaire de la formation professionnelle en France n’a cessé de s’épaissir, chaque réforme venant compléter ou bouleverser l’existant. En 1971, la loi Delors introduit la formation professionnelle continue et instaure une obligation de financement pour les entreprises. Ce socle s’est densifié en 1982, puis en 1991, généralisant la contribution obligatoire des employeurs.
Progressivement, le législateur a multiplié les outils : la loi de modernisation sociale de 2002 ajoute le bilan de compétences et le congé individuel de formation. En 2005, le contrat de professionnalisation apparaît, suivi en 2009 par la création du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
2014 marque un tournant avec l’arrivée du compte personnel de formation (CPF), repensant la logique d’accès au droit individuel. La loi Travail de 2016 rend la certification qualité obligatoire pour les organismes de formation. Puis, en 2018, la loi Avenir professionnel rebâtit l’ensemble : naissent les OPCO, les OPCA disparaissent, le CPF se monétise, la certification Qualiopi se généralise. L’année suivante, le législateur renforce l’influence des branches professionnelles et crée un fonds de transition professionnelle.
Le code du travail, dense et souvent jugé complexe, traduit la volonté d’ouvrir la formation à tous, tout au long de la vie. Aujourd’hui, dispositifs individuels, obligations collectives et pilotage sectoriel s’entremêlent pour façonner cet édifice.
Quels droits pour les salariés et obligations pour les employeurs ?
La formation irrigue désormais chaque contrat de travail. Dès l’embauche, l’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à son poste et soutenir sa capacité à évoluer. L’article L6321-1 du code du travail en fait une exigence forte qui guide la politique de formation interne, forçant parfois à arbitrer entre stratégie collective et projet individuel.
Les salariés disposent de plusieurs leviers concrets : le compte personnel de formation (CPF) et le bilan de compétences en font partie. Le recours au CPF en dehors du temps de travail ne requiert aucune validation, mais une formation durant les heures de présence suppose l’accord de l’employeur. S’ajoutent le congé de formation, la validation des acquis de l’expérience (VAE), ou encore les dispositifs de professionnalisation. L’accès à ces outils dépend aussi du dialogue social et de la qualité de l’information transmise par l’entreprise.
Pour clarifier les obligations de l’employeur, voici les points à retenir :
- Adapter les compétences face à l’évolution des postes
- Élaborer un plan de développement des compétences accessible à tous
- Associer les représentants du personnel à la politique de formation
La loi encadre également les partenariats avec les organismes de formation : seuls les prestataires Qualiopi accèdent aux financements publics ou mutualisés. Toute action de formation s’inscrit dans des conventions ou contrats précis, du contenu pédagogique jusqu’au suivi financier.
Quant au salarié, il garde la faculté de refuser toute formation en dehors de son temps de travail. En pratique, le chemin de la formation se dessine chaque jour entre les besoins de l’entreprise et les ambitions personnelles.
Zoom sur les dispositifs et financements accessibles aujourd’hui
Le système français de la formation professionnelle repose sur une diversité d’outils, soutenus par un cadre légal et financier solide. Le Compte Personnel de Formation (CPF) est désormais incontournable : chaque actif peut l’utiliser pour financer toute une gamme de formations certifiantes, du permis de conduire à la reconversion métier. Depuis la monétisation opérée par la loi Avenir Professionnel de 2018, l’accès est simplifié et l’autonomie renforcée.
Le plan de développement des compétences reste la colonne vertébrale de la stratégie formation en entreprise, organisant l’offre interne pour accompagner l’évolution des profils. Contrats de professionnalisation et apprentissage œuvrent au renouvellement des compétences en lien direct avec les besoins du marché. Les OPCO, opérateurs de compétences, orchestrent le financement, collectent les contributions et soutiennent les branches, notamment dans la transition numérique ou écologique.
Voici quelques dispositifs complémentaires à explorer :
- La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE), portée par France Travail, ouvre la voie à une embauche en formant les demandeurs d’emploi en amont.
- Le bilan de compétences, pour faire le point, repenser un parcours ou préparer une mutation professionnelle.
- La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), qui transforme l’expérience en certification reconnue.
La qualité des formations est surveillée de près par France Compétences et les DREETS, garantes de l’application des standards. La certification Qualiopi, devenue incontournable, conditionne l’accès aux financements publics. Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) donne de la visibilité à l’ensemble des titres reconnus par l’État.
Comprendre les évolutions récentes et anticiper les changements à venir
La formation professionnelle en France est en perpétuelle mutation. Les réformes s’enchaînent, portées par des défis nouveaux : transition écologique, transformation numérique, exigences européennes. Désormais, les OPCO orientent de plus en plus leurs financements vers l’acquisition de compétences liées à l’environnement ou au digital, tandis que les branches professionnelles adaptent leur offre pour accompagner les reconversions et les évolutions de carrière.
L’essor de l’intelligence artificielle et la montée en puissance de la régulation européenne, notamment via l’IA Act, placent la formation au cœur des enjeux de fiabilité et de sécurité. Les prestataires doivent renforcer la transparence des évaluations et ajuster leurs pratiques pédagogiques pour répondre à ces attentes.
Pour guider les actifs dans ce contexte mouvant, des dispositifs émergent : Mon CEP (Conseil en Évolution Professionnelle), animé par Avenir Actifs, propose un accompagnement individualisé, tandis que des outils comme Digiformaveille, développé par Digiforma, facilitent la veille réglementaire et l’anticipation des changements.
Face à cette dynamique, le secteur se mobilise pour garantir la qualité et la rapidité d’accès à l’information. La formation professionnelle, en France, n’a pas fini de se réinventer : elle avance, entre contraintes et opportunités, prête à façonner les carrières de demain.